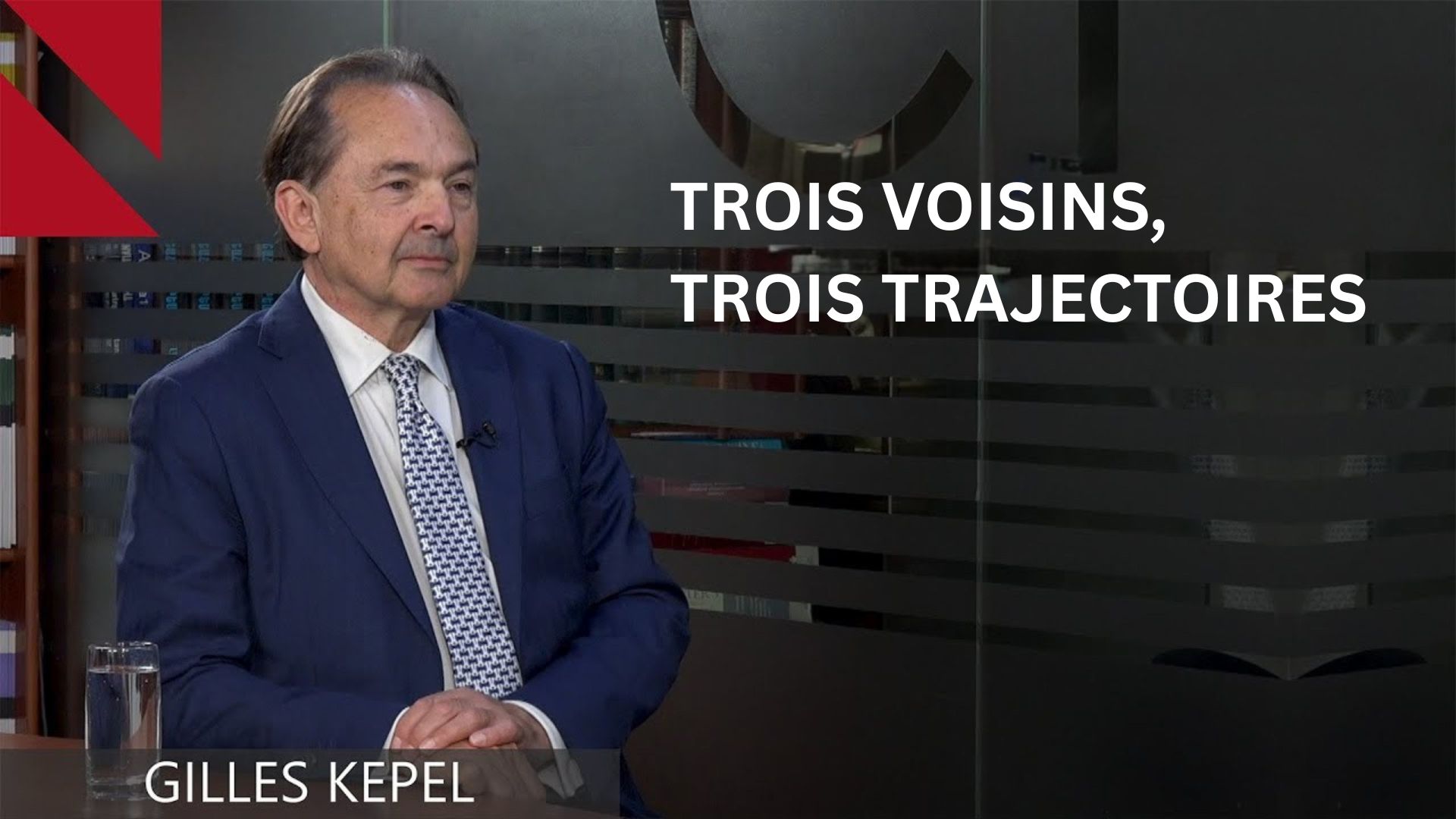
Professeur à Sciences Po Paris, spécialiste de renommée internationale du monde arabe, du jihadisme et des dynamiques de l’islam politique, Gilles Kepel est l’un des analystes les plus influents en Europe sur les enjeux géopolitiques du Moyen-Orient et les fractures internes du monde musulman contemporain. De passage à Erevan à l’invitation de l’Université française en Arménie, il a accordé un entretien à CivilNet. Il décrypte les recompositions en cours : un régime iranien au bord de l’implosion, une relation turco-azerbaïdjanaise qui annonce certaines mutations, une résurgence de l’islam politique dans le Caucase post-soviétique. Autant de signaux faibles qu’il convient de lire avec lucidité, alors que l’Arménie, carrefour géopolitique par excellence, cherche à réinventer sa position entre Europe, Russie et monde islamique.
Islam politique dans l’espace post-soviétique : un enjeu sous-estimé
Bien que l’Arménie soit un pays à majorité chrétienne, Kepel souligne que l’islam politique n’y est pas un sujet distant, car elle est entourée par trois États musulmans – la Turquie, l’Iran et l’Azerbaïdjan – chacun ayant une relation différente à la religion.
Contrairement à l’idée reçue selon laquelle les anciennes républiques soviétiques seraient à l’abri de la radicalisation, il rappelle la situation de la Tchétchénie et du Daghestan. Dans ces républiques de la Fédération de Russie, la religion est entre autres un outil utilisé par les élites cooptées par Moscou comme ressource à livrer. Moscou s’en méfie tout en l’utilisant. Dans le contexte de la guerre en Ukraine, le dirigeant tchétchène Ramzan Kadyrov a par exemple qualifié la guerre en Ukraine de « djihad ».
« L’islam politique est très présent dans le Caucase », affirme-t-il, et il se retrouve quelques fois jusqu’en France. G. Kepel est revenu sur les assassinats de Samuel Paty et de Dominique Bernard, enseignants français, par des ressortissants tchétchènes et ingouches, initialement réfugiés politiques.
En Asie centrale, ce phénomène est marginal.
Quant à l’Azerbaïdjan, Kepel note qu’il conserve une certaine forme de laïcité d’État, ce qui lui permet de se démarquer de son voisin et rival chiite, l’Iran,vis-à-vis de l’occident notamment. La France est très sensible à la notion de laïcité. Néanmoins en Azerbaïdjan, cette “laïcité” ultranationaliste dans le cadre d’un régime autocratique ne ressemble en rien à l’expérience française de la laïcité.
Turquie et Iran : des alliés de circonstance
Même si tout oppose la Turquie sunnite et l’Iran chiite, les deux régimes savent nouer des alliances tactiques, comme ce fut le cas dans le cadre du processus d’Astana sur la Syrie. Ce format de négociation entre la Russie, la Turquie et l’Iran visait à écarter les puissances occidentales du règlement du conflit syrien.
« L’accord d’Astana n’était pas idéologique mais géostratégique », souligne Kepel. Lors du Forum de Doha en décembre 2024, Moscou et Téhéran ont discrètement acté que le régime d’Assad n’était plus viable, pour éviter une mainmise d’islamistes armés sur les bases russes en Syrie.
Un régime iranien à bout de souffle
L’assassinat de Mahsa Amini, jeune Kurde arrêtée pour « port du voile inapproprié », a déclenché une vague de contestation sans précédent. La répression menée par le président Ebrahim Raisi fut brutale. Depuis sa mort suspecte dans un accident d’hélicoptère, les autorités iraniennes ont assoupli quelque peu leur position, car ils ne peuvent se permettre un affaiblissement cumulé de l’intérieur et de l’extérieur.
Dans les grandes villes, jusqu’à un tiers des femmes sortent sans voile, selon Kepel, et les forces de l’ordre ferment les yeux, submergées par d’autres crises : perte d’influence en Syrie et en Irak, affaiblissement du Hezbollah, crainte d’un affrontement direct avec Israël.
« L’Iran est dans une impasse, il doit se réformer ou s’effondrer », estime Kepel. Des négociations discrètes ont été entamées à Oman, entre les États-Unis – représentés par Stephen Vitkov, ancien promoteur immobilier devenu médiateur – et le ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araghchi. Leur poursuite est elle-même imprévisible.
Même dans les rangs des Gardiens de la Révolution, certains plaident pour une réforme interne pour éviter un soulèvement. Le président Pezeshkian et l’ex-ministre Javad Zarif incarneraient une ligne modérée, favorable à un compromis avec l’Occident pour préserver la nation.
Le dilemme nucléaire reste entier : l’Iran misera-t-il sur l’arme atomique comme outil de dissuasion ou acceptera-t-il un compromis avec l’Occident pour desserrer l’étau économique ?
Une frappe israélienne ou américaine pourrait soit durcir le régime, soit précipiter son effondrement.
Azerbaïdjan, Israël, Turquie : un triangle fragile
L’interview explore également les ressources de la relation Tel Aviv-Bakou et les difficultés de la triangulation avec Ankara. Si l’Azerbaïdjan entretient des liens solides avec Israël d’un côté et la Turquie de l’autre, des divergences existent sur la question palestinienne. L’Arménie reste une question tout à fait secondaire. Néanmoins, les vues d’Ankara et de Bakou ne sont pas totalement alignées sur la question du règlement du conflit. Ankara a un certain intérêt à ouvrir la frontière avec l’Arménie pour renforcer son influence régionale, mais le président Ilham Aliyev semble s’y opposer.
Selon Kepel, Aliyev se rêve un avenir monarchique sur le modèle des familles régnantes du Golfe. Il capitalise sur la manne énergétique pour renforcer son indépendance, y compris face à la Turquie, qui se voit pourtant comme leader du monde turcique. L’Azerbaïdjan pourrait dans un avenir proche revendiquer le rôle de premier plan dans la jonction entre l’Europe, la Turquie et l’Asie centrale, dans une forme de compétition avec la Turquie.
L’Arménie entre deux mondes
Kepel note la situation particulière de l’Arménie. La question de l’Islam politique dans la région est très différente selon qu’on la regarde de Washington, de Paris ou de Erevan. Des dilemmes sont devant l’Arménie. Européanisée culturellement, et même porteuse désormais d’un “destin européen” tout comme la Géorgie, l’Arménie ne peut pourtant pas faire sans la Russie ni l’Iran. Pour tous les membres de l’OTAN, l’Iran est une menace de premier ordre; tandis que pour l’Arménie, l’Iran est une “ligne de vie”. Ces paradoxes géopolitiques existent et dans “un système international devenu fondamentalement imprévisible depuis janvier 2020 », il est difficile de dire comment ils seront résolus, même si “caucasien en anglais signifie européen”, termine Gilles Kepel dans une pirouette.
