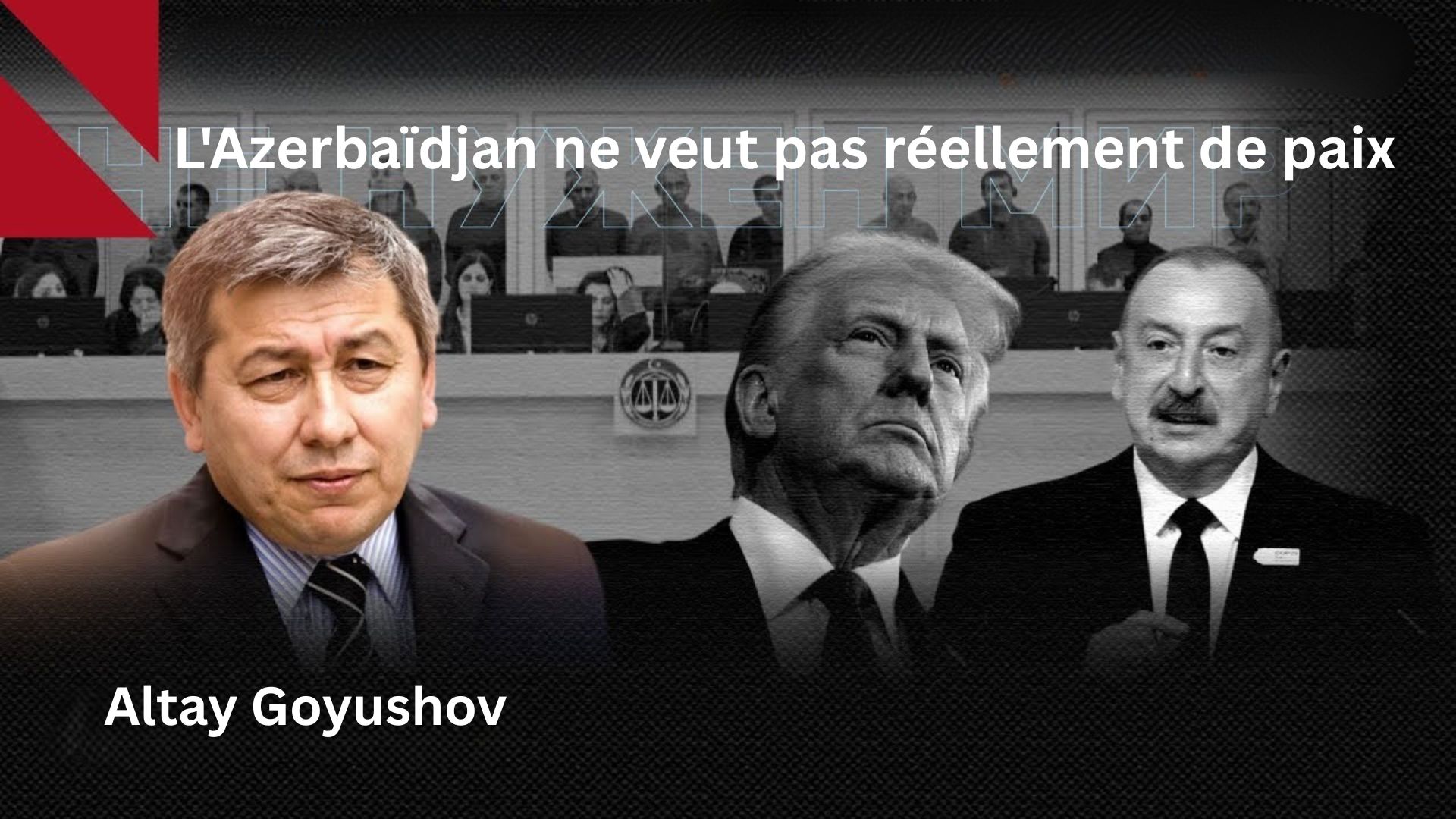
L’historien Altay Goyushov, directeur de l’Institut de recherche de Bakou (BRI), accueilli au CERI à Sciences Po en 2024-2025 en tant que chercheur en danger, a accordé un entretien à CivilNet dans lequel il revient sur la phase actuelle du processus de négociation entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan. Selon lui, malgré de récents accords sur certains points sensibles, l’Azerbaïdjan n’a pas véritablement l’intention de conclure une paix durable. Goyushov pointe également la pression exercée par les pays occidentaux, qui limite pour l’instant les velléités de reprise des hostilités à grande échelle. Au-delà de l’aspect militaire, il insiste surtout sur l’absence d’État de droit en Azerbaïdjan, un fait qui touche autant les prisonniers politiques azerbaïdjanais que les prisonniers arméniens détenus à Bakou.
C’est au milieu du mois de mars que les autorités arméniennes et azerbaïdjanaises ont annoncé avoir achevé leurs négociations sur deux questions particulièrement difficiles : le non-déploiement de forces de pays tiers le long de la frontière et le retrait des poursuites judiciaires introduites auprès d’instances internationales. Ces avancées laissent entrevoir un espoir, même modeste, de rétablissement d’une forme de paix durable. Pourtant, selon l’historien Altay Goyushov, la dynamique s’est très vite révélée trompeuse : l’Azerbaïdjan continue à accuser l’Arménie de violer chaque jour le cessez-le-feu et exige parallèlement la modification de sa Constitution, ce qui entretient l’idée d’une instabilité persistante.
Goyushov, qui dirige le Baku Research Institute, un centre de recherche que l’on peut qualifier de dissident par rapport au régime d’Aliyev, y voit une stratégie délibérée pour maintenir un statu quo ambigu : ni guerre ouverte, ni paix définitive. Ainsi, malgré les récentes déclarations laissant croire à des progrès substantiels, Bakou persiste à évoquer d’autres exigences — dont des changements constitutionnels et la remise en cause du rôle de la médiation internationale — pour faire pression sur Erevan.
L’historien souligne également que l’Arménie, ayant subi une défaite militaire lors de la dernière guerre, n’a aucun intérêt à ce qu’un climat d’affrontement perdure. Au contraire, Erevan n’a cessé d’exprimer sa volonté de parvenir à un accord de paix et de proposer la mise en place d’un mécanisme de surveillance des incidents, initiative à laquelle l’Azerbaïdjan ne répond pas. Goyushov estime dès lors qu’il est « très difficile de croire aux déclarations du gouvernement azerbaïdjanais » qui accuse Erevan de violer le cessez-le-feu quasi-quotidiennement depuis le 17 mars.
S’agissant des facteurs empêchant Bakou de recourir à des actions militaires d’envergure, Altay Goyushov met en avant la position des pays occidentaux — notamment la France et les États-Unis. Dans son analyse, une opération militaire à grande échelle de la part de l’Azerbaïdjan serait aussitôt perçue comme une grave provocation : « presque tous les pays européens blâmeraient sans ambiguïté le gouvernement azerbaïdjanais ». Par ailleurs, l’administration américaine, bien que restant discrète sur le plan intérieur azerbaïdjanais, demeure attentive à la situation. Donald Trump, pendant sa campagne électorale, avait émis la volonté de contribuer à la paix entre Erevan et Bakou ; or, pour l’heure, aucun réel rapprochement diplomatique ne semble s’opérer entre la Maison-Blanche et le président Ilham Aliyev. Bakou ne paraît donc pas souhaiter aggraver la situation, de crainte de s’aliéner ouvertement l’Occident.
En interne, Goyushov insiste sur le climat répressif qui persiste en Azerbaïdjan. Tous les journalistes indépendants et la plupart des acteurs de la société civile, s’ils ont le malheur de critiquer le pouvoir, se retrouvent derrière les barreaux. Cette absence de libertés fondamentales et de respect des droits humains complique, selon lui, tout rapprochement sérieux avec l’Occident. Washington, comme d’autres capitales occidentales, ne peut ignorer cette dérive autoritaire.
Abordant enfin la question du « procès exemplaire » mené à Bakou contre des prisonniers arméniens, Goyushov rappelle qu’il n’y a pas d’État de droit en Azerbaïdjan. La justice n’a pas d’indépendance par rapport au pouvoir politique, et ce, aussi bien pour les prisonniers politiques azerbaïdjanais que pour les détenus arméniens. L’historien note qu’il est difficile de juger, de l’extérieur, les véritables conditions de détention des captifs arméniens, car beaucoup d’informations relèvent de rumeurs ou de mises en scène médiatiques. En revanche, la tendance la plus claire demeure le « nationalisme exacerbé » d’une partie de la société azerbaïdjanaise, qui entretient l’image d’un ennemi héréditaire, contribuant ainsi à justifier des pressions sur les détenus arméniens.
Toutefois, la « faiblesse structurelle » de la justice dans le pays fait qu’il est impossible, affirme Goyushov, de considérer un procès comme équitable. « Il ne peut y avoir un traitement équitable pour un Arménien et inéquitable pour un Azerbaïdjanais, ou l’inverse », fait-il valoir. Selon lui, le consensus nationaliste repose sur une méfiance générale, voire une acceptation tacite du caractère politique des jugements, alimentant un climat où la justice demeure instrumentalisée.
Au terme de cette analyse, Goyushov en conclut que l’Azerbaïdjan se contente, pour l’instant, de conserver une situation d’« incertitude prolongée », sans avancée diplomatique concrète ni nouveau conflit ouvert. Selon l’historien, l’influence occidentale reste le principal frein à une escalade, tandis que l’absence d’État de droit et l’intolérance vis-à-vis des opposants comme des Arméniens continuent de peser lourdement sur toute perspective de paix durable.
